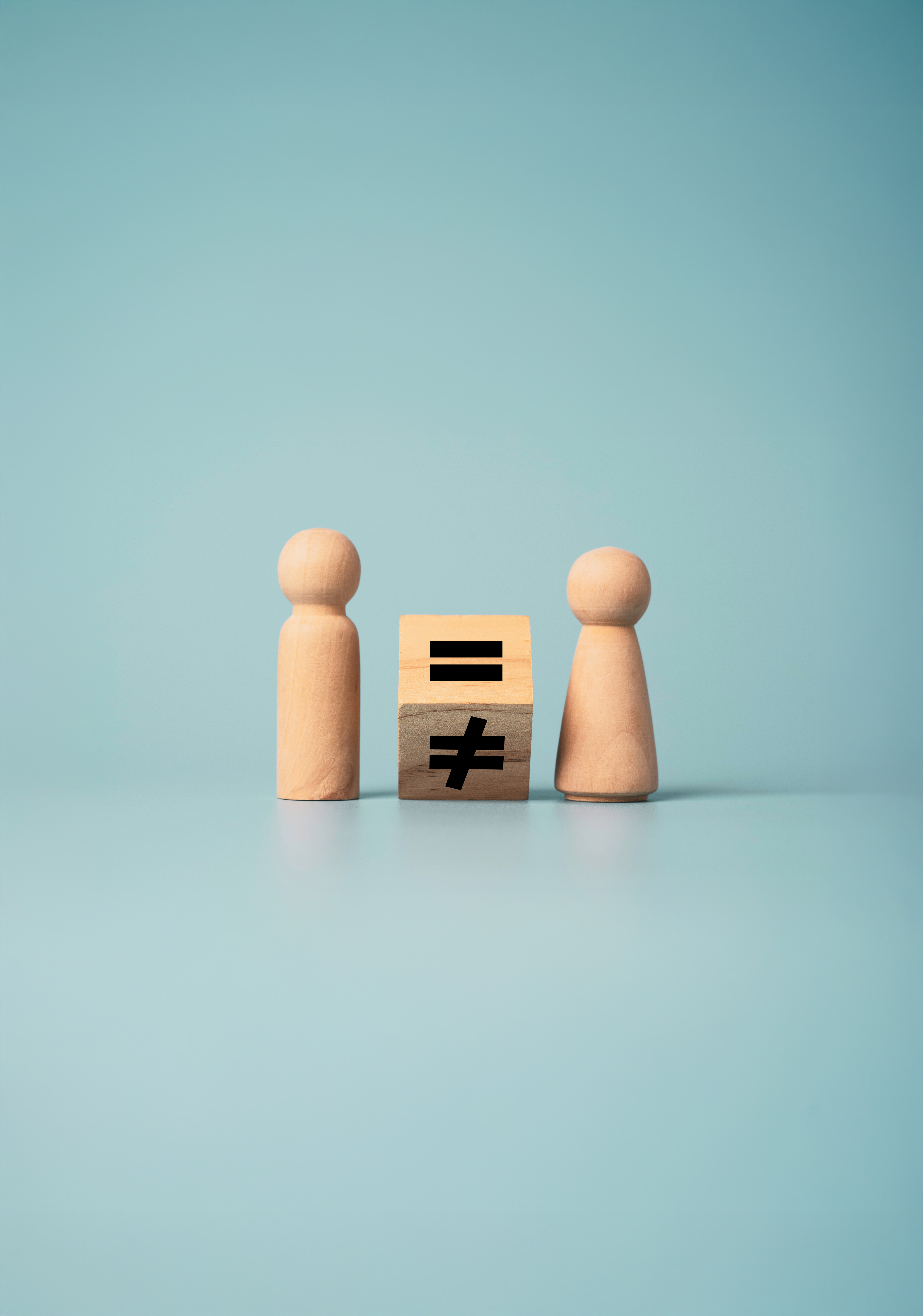Dialogue citoyen
Place publique 25-26 : une saison pour nourrir sa réflexion
Publié le | Mis à jour le
Sommaire
Et si nous prenions le temps de réfléchir ensemble ? Cette année encore, Place publique vous donne rendez-vous chaque mois pour débattre des questions qui agitent notre société. Zoom sur cette nouvelle saison de débats.
Sommaire
Des vies sous l’influence des algorithmes, l’avenir du service public en question, le tabou de la ménopause ou encore l’instabilité géopolitique… Le programme de cette saison 2025-2026 s’annonce aussi riche que brûlant d’actualité !
Depuis plus de 20 ans, Place publique fait vivre le débat d’idées à Saint-Herblain. Dans un monde où tout s’accélère, ce rendez-vous citoyen, proposé par la Ville, invite à s’arrêter, à écouter, à discuter… bref, à penser ensemble les grands enjeux de notre époque.
Pour cette saison 25-26, le principe reste inchangé : chaque mois, un thème fort, un panel d’intervenants (universitaires, journalistes, responsables associatifs, grands témoins, etc.) et surtout, un public invité à prendre la parole.
Les débats Place publique sont gratuits, ouverts à toutes et tous. Pour permettre aux personnes malentendantes de prendre pleinement part aux échanges, la Ville de Saint-Herblain propose une traduction des échanges en langue des signes française sur place et en direct (lire ci-dessous).
Les algorithmes influencent nos vies dans plusieurs domaines : consommation culturelle, loisirs, accès aux prêts bancaires, tarification de certains services, sélection de candidats à l’embauche, études supérieures, rémunérations, allocations, suivi médical, etc. Leur utilisation pose des questions fondamentales sur le respect des droits des usagers, sur leur libre arbitre… Comment les algorithmes fonctionnent-ils ? Dans quels domaines sont-ils utilisés ? Sont-ils vraiment équitables ? Quels usages positifs nous apportent-ils ?
Entraînés par des données entrées par des hommes et des femmes, les algorithmes risquent d’être le reflet de biais cognitifs et donc de désavantager certaines personnes au profit d’autres. Comment encadrer ces effets négatifs ? Quelles questions éthiques posent-ils ? Une information auprès des citoyennes et citoyens peut-elle les alerter sur la logique des algorithmes et les aider à prendre part au débat ?
En partenariat avec l’entreprise herblinoise Mazedia dans le cadre de la Nantes Digital week.
Pour en débattre :
- Gabrielle du Boucher, chargée de mission numérique, droits et libertés au Défenseur des droits et auteure du rapport sur « les algorithmes, systèmes d’IA et les services publics : quels droits pour les usagers ? ;
- Thibault Grison, maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université de Lille ;
- Florence Jacob, maître de conférences en management à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Nantes, spécialiste en marketing et innovation digitale ;
- Matthieu Perreira Da Silva, maître de conférences à Nantes Université, Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes.
Un débat animé par Antony Torzec, journaliste.
En France, la liberté de création artistique est un principe garanti par la loi et reconnu comme un pilier de la démocratie culturelle. Mais est-ce une réalité ? Malgré un cadre juridique protecteur, cette liberté semble de plus en plus mise à l’épreuve : annulations de spectacles, pressions politiques ou idéologiques, controverses médiatiques ou campagnes sur les réseaux sociaux… Certaines œuvres disparaissent avant même d’avoir existé.
Entre volonté de protéger les sensibilités et risques de censure, les artistes évoluent dans un contexte où l’auto censure gagne du terrain, où les financements sont parfois conditionnés à des critères moraux et politiques, où l’opinion publique influe sur les choix culturels… Aujourd’hui, qui décide de ce qui est culturellement acceptable ? De nouvelles formes de pression pèsent-elles sur la création artistique ? Sommes-nous face à une censure plus insidieuse ?
Pour débattre de ces questions :
- Anna Arzoumanov, maîtresse de conférences en langue et littérature françaises (Sorbonne université), détachée au CNRS, cotitulaire de la chaire de recherche franco-canadienne sur les enjeux contemporains de la liberté d’expression ;
- Catherine Blondeau, directrice de Mixt, Terrain d’arts en Loire-Atlantique ;
- FRAP, dessinateur de presse ;
- François Lecercle, vice-président de l’Observatoire de la liberté de création.
Le débat est animé par le journaliste Alexandra Jore.
Elle touche 17 millions de femmes en France, bouleverse souvent leur quotidien, a parfois des incidences sur leur santé, leur vie professionnelle… Pourtant, la ménopause, longtemps réduite à la sphère de l’intime, émerge dans le débat public depuis quelques années. Derrière la parole qui se libère — témoignages, prises de parole médiatiques, livres, podcast, rapport parlementaire, etc. — une question persiste : pourquoi cette étape de vie reste-t-elle si peu prise en compte ? Invisibilisation dans le monde du travail, manque d’information, poids des stéréotypes… Bien plus qu’un processus physiologique, la ménopause et le silence qui l’entoure interrogent notre rapport collectif au corps féminin et à l’âge. Quelles pistes pour faire évoluer le regard sur cette étape de la vie, et plus encore sur le vieillissement féminin ?
- Dr Maxime Chaillot, gynécologue au CHU de Nantes et au centre hospitalier de Châteaubriant ;
- Cécile Charlap, sociologue et chercheuse à l’université de Toulouse et autrice du livre La fabrique de la ménopause ;
- Sophie Dancourt, journaliste spécialiste de la question du vieillissement des femmes et fondatrice du média J’ai piscine avec Simone.
Un débat animé par Alexandra Jore, journaliste
Depuis la Révolution française, le secours aux enfants assistés est confié aux départements qui deviennent, avec les lois de décentralisation de 1983, les chefs de file de cette politique publique. En 2025, 400 000 enfants en danger sont confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Ces placements doivent protéger leur intégrité physique et morale et leur permettre de grandir normalement. Comment fonctionne l’aide sociale à l’enfance ? Qui sont les acteurs de cette politique publique ? Quel est l’état des lieux de l’aide sociale à l’enfance ?
Après plusieurs drames qui ont touché des enfants placés, une commission d’enquête parlementaire a mené plus de 60 auditions qui révèlent un système à bout de souffle. Des départements peu soutenus dans leur mission, des contrôles inexistants, un manque de vision stratégique, tels sont les constats. À quoi il faut ajouter l’absence d’une politique de prévention auprès des familles, autour de la lutte contre la pauvreté et l’accompagnement à la parentalité. Quelles sont les préconisations formulées par la commission d’enquête et les perspectives ?
Pour en débattre :
- Serge Michel, directeur du SEAD, service milieu ouvert à l’Adaes44 ;
- Alissa Denissova, fondatrice de l’association Repairs 44, association d’entraide destinée aux jeunes sortant de la protection de l’enfance ;
- Marine Verron, avocate spécialiste du droit des familles et des mineurs.
Un débat animé par Alexandra Jore, journaliste
Profiter d’une vie relationnelle, affective et sexuelle est souvent un parcours semé d’embûches pour les personnes en situation de handicap. Si les situations diffèrent en fonction de la nature du handicap, la question de la sexualité demeure particulièrement un impensé pour la société. Un déni peut exister chez certains parents quant à la sexualité de leur enfant tandis que de nombreux professionnels se trouvent démunis faute de formation sur cette problématique. Quelle image la société a-t-elle de la vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap ? Comment en parler et faire tomber les préjugés ? Quid de la santé gynécologique ?
Alors que les espaces propices aux rencontres sont peu nombreux, l’absence de prise en compte des émotions et des souhaits de vie affective peut déboucher sur des souffrances individuelles et collectives. Si certains pays ont choisi d’autoriser l’exercice de la profession d’assistant sexuel, la France continue d’assimiler cette activité à de la prostitution. Quel accompagnement peut-il être proposé ? Comment la question du consentement peut-elle être abordée? Que recouvre le métier d’assistant sexuel ?
Pour en débattre :
- Audrey Hervouet, psychologue clinicienne et sexologue, membre du collectif T’Cap, centre de ressources « Culture, handicap et vie sociale »;
- Isabel Da Costa, membre du conseil d’administration de l’APF France handicap ;
- Carole Landelle, coordinatrice d’Intimagir Pays de la Loire, centre ressource dédié à la vie intime, affective, sexuelle et au soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap, chargée de projet en éducation et promotion de la santé à Promotion santé Pays de la Loire.
Un débat animé par Pascal Massiot, journaliste
En partenariat avec le collectif T’Cap, centre de ressources « Culture, handicap et vie sociale ».
Crise des Gilets jaunes, personnels soignants et professeurs en situation d’épuisement, recul des services publics … Dans certains territoires, un sentiment d’abandon de l’État est vécu par les Françaises et les Français. Paradoxalement, ils sont nombreux à se dire étranglés par les impôts et taxes. À l’heure où les besoins et les modes de vie évoluent, que doivent englober les services publics ? Sont-ils encore des vecteurs de cohésion sociale ? Doivent-ils encore s’inscrire dans un principe d’égalité et d’équité pour répondre à un impératif de justice sociale alors même que les ressources fiscales s’épuisent ? La définition française du service public est-elle compatible avec l’approche européenne du service universel ?
Au final, après 40 ans de conquêtes d’individualisme libéral, l’idéal collectif est-il encore assez fort pour protéger et proposer un service public de qualité accessible à tous ?
Pour en débattre :
- Claire Lemercier, directrice de recherche CNRS en histoire et membre du Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris. Co-autrice de « La haine des fonctionnaires » et « La valeur du service public » ;
- Rodrigue Murzeau, directeur du pôle ressources humaines de Mauges Communauté et membre du réseau Le Lierre, réseau de professionnels de l’action publique engagés pour la transition écologique et solidaire ;
- Stéphane Vincent, cofondateur et délégué général de La 27e Région, laboratoire d’innovation publique qui accompagne les collectivités – dont Nantes Métropole – dans la transformation des politiques et pratiques publiques.
Un débat animé par Jean Chabod, journaliste.
Alors que l’égalité entre les sexes progresse, un sujet reste encore peu exploré : l’argent. De l’écart salarial aux inégalités patrimoniales, de la précarité professionnelle à la dépendance financière dans le couple, les femmes restent globalement moins riches… partout dans le monde. Une réalité qui s’observe tout au long de la vie : de l’argent de poche à la retraite. Ces écarts économiques sont parfois invisibles, mais leurs effets sont profonds : ils limitent l’autonomie, renforcent les inégalités, et peuvent devenir une forme de violence silencieuse — la violence économique — encore peu reconnue en droit, mais bien réelle dans les faits. Partage inégal des dépenses, carrières freinées par la maternité… Quels mécanismes fabriquent et entretiennent ces inégalités ? Pourquoi perdurent-ils et que disent-ils de notre société ? Comment repenser les modèles, interroger les politiques publiques, et faire de l’autonomie économique des femmes un enjeu démocratique ?
Pour en débattre :
– Hervé Gransart, président de l’association SOlidarité femmeS Loire-Atlantique
– Lucile Peytavin, historienne spécialiste des droits des femmes, autrice du livre « Le coût de la virilité » et membre de l’Observatoire de l’émancipation économique des femmes (Fondation des femmes)
– Marie-Lahya Simon, créatrice du podcast et du compte Instagram A parts égales et autrice du livre « Ils vécurent heureux… et prirent un compte commun »
Un débat animé par Mathilde Chevré, journaliste
Le multilatéralisme est en crise. Les organisations internationales comme l’ONU peinent à agir face à l’unilatéralisme dont font preuve les États-Unis, la Chine et la Russie. Pour les dirigeants de ces États, la force et la contrainte constituent les nouvelles manières de régir leurs relations internationales. Guerres d’invasions, d’annexions, cyberattaques, sabotages, provocations militaires, corruptions, présence massive dans les institutions internationales, fake news… les faits et gestes de certains États traduisent leur insatiable désir de puissance. Ainsi, n’assiste-t-on pas au retour de la géopolitique, autrement dit des rapports de force liés à la détention de territoires ? De par leur histoire, la Chine, les États-Unis et la Russie, se considèrent toujours comme des empires manifestant de façon continue leur souhait de domination. Quelles sont les racines historiques et idéologiques de cet appétit ? Dans quels domaines la compétition géopolitique se déploie-t-elle ?
Un débat animé par Pascal Massiot, journaliste
En France, 8,5 millions d’adultes sont en situation d’obésité. Au niveau mondial, elle touchera 6 adultes sur 10 et 1 enfant / adolescent sur 3 en 2050 si les pouvoirs publics ne réagissent pas. Comment expliquer cette épidémie ? Quels sont les facteurs déclencheurs ? À quel stade en est la France ? L’obésité peut être due à plusieurs facteurs que sont la sédentarité, l’alimentation, généralement considérée comme une variable d’ajustement après le logement et les transports. Victimes de stigmatisation, de préjugés et d’invisibilisation, les personnes obèses se mobilisent au travers d’associations pour lutter contre la grossophobie et faire reconnaître l’obésité comme maladie chronique. Quels types de messages de santé publique peuvent-être imaginés ? Quelles représentations médicales pèsent sur l’obésité et le surpoids ? Quelles en sont les conséquences ? Comment changer le regard de la société sur l’obésité ?
Un débat animé par Mathilde Chevré, journaliste
Un soupçon de pesticides, une pincée de microplastiques… Et si l’eau que nous buvons chaque jour n’était plus aussi pure qu’on le pense ? Ressource vitale et pourtant de plus en plus menacée, l’eau potable est l’un des produits alimentaires les plus contrôlés. Malgré cela, en 2023, un quart des Français ont bu une eau non conforme, selon le ministère de la Santé.
Face à la pollution des sols, à la complexité croissante des traitements, aux normes parfois floues et aux pratiques douteuses de certains industriels, qui veille réellement sur la qualité de notre eau ? Quels sont les risques ? Entre droit fondamental, enjeux sanitaires et intérêts économiques, l’eau demeure une source (inépuisable) de débat.
Un débat animé par Antony Torzec, journaliste
Les 10 débats sont programmés de 20h à 22h, à l’auditorium de la Maison des Arts.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez suivre les débats en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain.
Place publique, 20h-22h, un jeudi par mois de septembre à juin.
Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire.
Renseignements : 02 28 25 20 28 / communication@saint-herblain.fr
Traduction en langue des signes
Pour bénéficier traduction des échanges en langue des signes française sur place et en direct, contacter le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat :
- par mail à l’adresse : communication@saint-herblain.fr
- par téléphone au 02 28 25 20 28.
Accès transports en commun
- À 250 m, 3 minutes à pied : bus lignes 23, 59, 91, 81 arrêt Maison des Arts.
- À 550 m, 7 minutes à pied : tramway ligne 1, arrêt Romanet.
- À 650 m, 8 minutes à pied : tramway ligne 1, chronobus C20, bus lignes 131, 23, 40, 59, 81, 91, arrêt Mendès-France-Bellevue.
Accès vélo
- Depuis la place de l’Abbé-Chérel (place de l’Église) : 3,8 km, 15 minutes.
- Depuis le rond-point Abel-Durand (ex rond-point des Châtaigniers) : 1,8 km, 6 min.
- Depuis la place Zola à Nantes : 2,5 km, 8 minutes.
- Depuis le musée Jules-Verne à Nantes : 3,8 km, 13 minutes.
De nombreux stationnements vélos sont disponibles devant la Maison des Arts.